LE TEMPS ET SA
MESURE
I-
Les instruments de l’Antiquité
a) Le cadran solaire
 Les
gnomons et les cadrans solaires sont les premiers instruments de mesure connus.
Fondés sur le déplacement relatif du Soleil par rapport à la Terre, ils ne pouvaient
fonctionner que le jour, par temps ensoleillé, et n'indiquaient qu'approximativement
l'heure.
Les
gnomons et les cadrans solaires sont les premiers instruments de mesure connus.
Fondés sur le déplacement relatif du Soleil par rapport à la Terre, ils ne pouvaient
fonctionner que le jour, par temps ensoleillé, et n'indiquaient qu'approximativement
l'heure.
Le principe : L'extrémité de l'ombre d'un bâton planté
verticalement parcourt très régulièrement un arc de cercle : on fabrique un
instrument formé d'une tige, et d'un cadran, horizontal ou vertical, sur lequel
sont gravés des traits indiquant l'heure. Quand la Terre tourne, l'ombre de
la tige se déplace sur le cadran et indique l'heure. Attention, il nous donne
l'heure solaire. En France, il faut donc ajouter deux heures en été et une heure
en hiver pour obtenir l'heure exacte.
b) L’horloge à eau ou la clepsydre
 Si
le cadran solaire donne l'heure pendant le jour, la clepsydre fait la même chose
la nuit, et elle mesure en plus des durées plus brèves avec une bonne précision.
Les clepsydres sont des horloges à eau.
Si
le cadran solaire donne l'heure pendant le jour, la clepsydre fait la même chose
la nuit, et elle mesure en plus des durées plus brèves avec une bonne précision.
Les clepsydres sont des horloges à eau.
Le principe : Un vase percé d'un trou laisse couler de l'eau. Des graduations
situées à l'intérieur permettent de mesurer des intervalles de temps.
c) le sablier
Si on ne voit pas beaucoup la clepsydre dans un pays où l'eau est rare, elle
est remplacée sans problème par le sablier. Son inconvénient est qu'il faut
souvent le retourner pour mesurer des intervalles de temps relativement longs,
mais il indique avec une bonne précision la durée d'une tâche à accomplir.
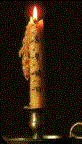 d)
Les horloges à encens à bougie et à huile
d)
Les horloges à encens à bougie et à huile
 En
Chine, le temps est aussi mesuré par la combustion lente d’un bâton d’encens
qui brûle un fil ; ce fil est relié à une boule qui tombe dans un récipient
métallique marquant ainsi une certaine durée.
En
Chine, le temps est aussi mesuré par la combustion lente d’un bâton d’encens
qui brûle un fil ; ce fil est relié à une boule qui tombe dans un récipient
métallique marquant ainsi une certaine durée.
Avant le Moyen Age, on utilisait aussi la combustion de la cire ou de l'huile
pour connaître le temps écoulé.
II-
Les
instruments du Moyen-Age au XVIIème siècle
a) Horloge à Verge et Foliot
 Entre
le XIème et le XIIIème siècle, un moine eût l'idée de l'horloge mécanique moins
sensible que les horloges à eau aux changement de températures et de pressions
atmosphériques
Entre
le XIème et le XIIIème siècle, un moine eût l'idée de l'horloge mécanique moins
sensible que les horloges à eau aux changement de températures et de pressions
atmosphériques
Son principe : un poids suspendu à une corde fournit de l'énergie à la machine
tandis qu'un système de blocage interrompt régulièrement la chute du lest.
Très vite cette horloge à verge et foliot va faire le tour des murs des monastères
et finalement conquérir les cités.
b) Horloges à ressort spiral et fusée
L'horloge mécanique s'impose au XIIIème siècle. Elles sont très populaires,
mais peu pratiques car leur construction revient cher et leur encombrement est
important. Un ressort comprimé, auquel s'adjoint "la fusée" qui fournit
de l'énergie en remplacement du poids qui tombe rend ces horloges transportables.
A partir du XIIIème siècle, les dispositifs ne cessent de gagner en précision.
De 15 minutes par jour au XIIIème siècle, la précision passe à 15 seconde par
jour à partir de 1650.
III-
Les
instruments plus récents
a) la montre et l’horloge à quartz
Le quartz a la particularité, comme d'autre minéraux tel le
saphir, de générer des charges électriques à sa surface lorsqu'on exerce sur
lui des forces mécaniques : c'est l'effet piézo-électrique découvert par le
physicien français Pierre Curie.
Tout choc sur un cristal engendre donc des vibrations mécaniques,
d'amplitude maximale selon des directions particulières (axes mécaniques), lesquelles
sont la cause de charges électriques variables. On obtient ainsi un oscillateur
électrique dont la fréquence de vibration est propre au quartz lui-même. La
fréquence des oscillations est très stable pourvu que le cristal conserve ses
dimensions. Ces vibrations, mises en forme et associées à un moteur synchrone,
sont à l'origine du mouvement des aiguilles d'une montre. La précision obtenue
est dix fois plus grande que celle de la meilleure des montre mécanique : une
seconde de retard en six ans.
b) L’horloge atomique
Toujours à la recherche de la meilleure précision,
pour répondre aux besoins des télécommunications ou de la navigation, en 1958
est mise au point l'horloge atomique, dont la précision est de 1 seconde pour
3000 ans. Le principe est basé sur le fait qu'un atome absorbe ou émet de l'énergie
à une fréquence encore plus précise que celle du quartz. L'atome retenu est
le césium Cs.
On utilise la fréquence très précise de certaines radiations
émises par l’atome de Césium pour créer un signal d’horloge. La dérive de la
fontaine à Césium (dernier modèle) est inférieure à 1 seconde sur 15 millions
d’années.
 Les
gnomons et les cadrans solaires sont les premiers instruments de mesure connus.
Fondés sur le déplacement relatif du Soleil par rapport à la Terre, ils ne pouvaient
fonctionner que le jour, par temps ensoleillé, et n'indiquaient qu'approximativement
l'heure.
Les
gnomons et les cadrans solaires sont les premiers instruments de mesure connus.
Fondés sur le déplacement relatif du Soleil par rapport à la Terre, ils ne pouvaient
fonctionner que le jour, par temps ensoleillé, et n'indiquaient qu'approximativement
l'heure. Si
le cadran solaire donne l'heure pendant le jour, la clepsydre fait la même chose
la nuit, et elle mesure en plus des durées plus brèves avec une bonne précision.
Les clepsydres sont des horloges à eau.
Si
le cadran solaire donne l'heure pendant le jour, la clepsydre fait la même chose
la nuit, et elle mesure en plus des durées plus brèves avec une bonne précision.
Les clepsydres sont des horloges à eau. 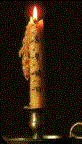 d)
Les horloges à encens à bougie et à huile
d)
Les horloges à encens à bougie et à huile  En
Chine, le temps est aussi mesuré par la combustion lente d’un bâton d’encens
qui brûle un fil ; ce fil est relié à une boule qui tombe dans un récipient
métallique marquant ainsi une certaine durée.
En
Chine, le temps est aussi mesuré par la combustion lente d’un bâton d’encens
qui brûle un fil ; ce fil est relié à une boule qui tombe dans un récipient
métallique marquant ainsi une certaine durée.  Entre
le XIème et le XIIIème siècle, un moine eût l'idée de l'horloge mécanique moins
sensible que les horloges à eau aux changement de températures et de pressions
atmosphériques
Entre
le XIème et le XIIIème siècle, un moine eût l'idée de l'horloge mécanique moins
sensible que les horloges à eau aux changement de températures et de pressions
atmosphériques